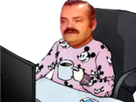SI 100 PAGES AVANT 16h30
Le 10 septembre 2017 à 16:22:45 fuckphp a écrit :
Le 10 septembre 2017 à 16:21:41 OussiYotinkak a écrit :
Le 10 septembre 2017 à 16:21:12 arte567 a écrit :
Et si on débattait sur un sujet pourris pour rameuter les jean-bien pensant et feeder plus vite ?Que pense-tu de la situation au moyen-orient ?
mais attention pas d'incitation à la haine, évidement
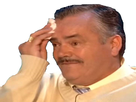
C'est un complot des sionistes et des wahabites pour prendre le control de toute la région et pour refaire le moyen orient.
![[[sticker:p/1jnh]]](https://image.jeuxvideo.com/stickers/p/st/1jnh)
Le 10 septembre 2017 à 16:30:08 -_Arthalys_- a écrit :
Ayaaaaaaa plus qu'une minute et c'est que la moitié
Encore trente minute khey n'abandonne pas
Le 10 septembre 2017 à 16:30:34 GISMO66 a écrit :
Si 50 pages avant 16 h 30 tu te mets au moins la balayette dans le cul l'auteur ?
fait! il a dit qu'il fait tout pour 17h .gif)
.gif)
![[[sticker:p/1lm9]]](https://image.jeuxvideo.com/stickers/p/st/1lm9)
La gare de Paris-Nord, dite aussi gare du Nord, constitue la tête de ligne parisienne du réseau ferroviaire desservant le nord de la France, ainsi que les pays limitrophes. Du fait de la proximité de la Belgique, des Pays-Bas, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, elle a toujours possédé une vocation internationale marquée, avant de voir son trafic régional se développer fortement. C'est, hors Japon, la première gare du monde en termes de trafic2 ; elle a accueilli 262 millions de voyageurs en 2015.
Ouverte en 1846 par la Compagnie des chemins de fer du Nord en tant qu'embarcadère de la ligne de Paris-Nord à Lille, la gare constitue un « carrefour intermodal » majeur de la capitale, où coexistent trains à grande vitesse (desserte nationale — avec TGV — et internationale — avec Eurostar et Thalys —), trains de grandes lignes (Intercités) et TER Hauts-de-France, Transilien, RER, métro, bus, taxi et Vélib'.
La gare du Nord fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 15 janvier 1975.
Sommaire [masquer]
1 Situation ferroviaire
2 Histoire
2.1 Chronologie
2.2 Les origines
2.3 Un trafic de banlieue en hausse constante
2.4 Des années 1930 à l'après-guerre
2.5 L'électrification Nord - Paris
2.6 La gare souterraine
2.7 Le TGV Nord
2.8 La création du RER E
2.9 L'opération « Gare du Nord Échanges »
2.10 Un contexte social difficile
2.11 De nouveaux réaménagements
3 Architecture
3.1 Reconstruction et agencements
3.2 Buffet de gare
4 Urbanisme
5 Desserte voyageurs
5.1 Histoire des dessertes de grandes lignes
5.1.1 L'ère des trains mythiques
5.1.2 L'arrivée du TGV
5.2 Histoire des dessertes de banlieue
5.3 La desserte régionale
5.3.1 Généralités
5.3.2 Lignes B et D du RER
5.3.3 Lignes H et K du Transilien
5.3.4 Ligne E du RER
5.4 La desserte nationale
5.5 La desserte internationale
5.5.1 Transport ferroviaire
5.5.2 Transport aérien
6 Correspondances
7 Service des marchandises
8 Dépôts et ateliers
9 Dans la culture
9.1 Dans la littérature
9.2 Au cinéma
9.3 À la télévision
9.4 Dans la chanson
10 Documentaires
11 Notes et références
12 Voir aussi
12.1 Bibliographie
12.2 Articles connexes
12.3 Liens externes
Situation ferroviaire[modifier | modifier le code]
La gare de Paris-Nord est établie dans le 10e arrondissement de Paris, à cinquante-trois mètres d'altitude, dans un environnement urbain très dense. Elle est voisine de la gare de Paris-Est, distante de moins de deux cents mètres au sud-est. La gare constitue la tête de ligne du réseau ferré issu de la Compagnie des chemins de fer du Nord, desservant le nord de la France ainsi que les pays limitrophes. Elle dessert par ailleurs une vaste zone de la banlieue nord de Paris, s'étendant de Pontoise à l'ouest, à Mitry-Mory à l'est, par le biais de plusieurs lignes formant un éventail, et lui assurant un trafic de voyageurs particulièrement élevé.
Vue d'ensemble des voies, prise depuis la gare routière.
Vue d'ensemble des voies, prise depuis la gare routière.
Avec une dotation de trente-deux voies à quai depuis 1993, dont quatre souterraines, la gare du Nord occupe, en France, la première place. Sur cet ensemble, d'ouest en est, on trouve la voie 2 (la voie 1 a été supprimée) entre le bâtiment de La Poste et la zone sous contrôle pour l'Eurostar, quatre voies sous douane réservées au service Eurostar, quinze voies destinées aux services Thalys, grandes lignes (TGV et Intercités) et TER Hauts-de-France, sept voies pour les services de la banlieue Nord d'Île-de-France (ligne H et ligne K du réseau Transilien), et sous ces dernières une gare souterraine composée de quatre voies utilisées par le trafic des lignes B et D du RER3. La tranchée s'étendant au nord de l'établissement compte quatorze voies, dont quatre à l'est destinées au seul trafic de banlieue. S'y ajoutent quatre voies souterraines sous ces dernières, se dirigeant vers la gare souterraine et au-delà, vers les lignes interconnectées de la banlieue sud4.
Sur l'ensemble des voies de surface, la vitesse est limitée à 60 km/h.
La vaste zone d'avant-gare s'étale sur plus de quatre kilomètres ; elle est, de loin, la plus complexe du réseau ferré français, avec la présence de nombreux sauts-de-mouton permettant le reclassement des voies. Au point kilométrique (PK) 3,458, les quatre voies de la ligne de La Plaine à Hirson et Anor se débranchent de la ligne de Paris-Nord à Lille par une série de sauts-de-mouton. Plus loin au nord, la ligne de Saint-Denis à Dieppe, également dotée de quatre voies sur ce tronçon jusqu'à la bifurcation d'Épinay - Villetaneuse, se débranche à niveau vers le nord-ouest, peu après la gare de Saint-Denis. La ligne Paris - Lille se dirige alors vers le nord-est avec une dotation de quatre voies4.
La zone d'avant-gare dispose de plusieurs faisceaux de garage et d'ateliers de maintenance du matériel roulant. On trouve successivement en quittant la gare : le site de La Chapelle du technicentre Paris-Nord, à l'ouest, puis le site de remisage banlieue à proximité de La Chapelle-International à l'est, puis au-delà du boulevard périphérique, le site du Landy à l'ouest, avec l'atelier de maintenance du parc TGV et un vaste complexe de remisage grandes lignes5.
En 2009, la gare a géré 1500 circulations par jour, ce qui constitue de loin le record de France. Elle surpasse dorénavant la gare de Paris-Saint-Lazare, avec ses 1200 circulations, ainsi que les quatre autres grandes gares parisiennes de Paris-Est, Paris-Lyon, Paris-Montparnasse et Paris-Austerlitz, avec respectivement 800, 750, 700 et 600 circulations. Sur ce total, 970 trains se dirigent vers Saint-Denis et au-delà, et 530 se dirigent vers Aulnay-sous-Bois. Deux sens confondus, ce sont quotidiennement 800 trains qui entrent en gare souterraine, dont 510 pour la ligne B du RER, et 290 pour la ligne D. En surface, la gare accueille 700 trains, dont 396 trains vers la gare banlieue, 360 trains pour la ligne H, ainsi que 36 pour la ligne K, un peu plus de 200 TGV et 100 Intercités (IC)6.
Les premiers points d'arrêt rencontrés en quittant l'établissement sont les gares de Stade de France - Saint-Denis, au PK 4,180 de la ligne de Paris-Nord à Lille desservie par les trains de la ligne D du RER, et celle de La Plaine - Stade de France, au PK 4,501 de la ligne de La Plaine à Hirson desservie par les trains de la ligne B du RER7.
Histoire[modifier | modifier le code]
Chronologie[modifier | modifier le code]
Ambiance de l'avant-gare de la gare du Nord, avant la Première Guerre mondiale.
25 janvier 1846 : inauguration de la section Paris – Clermont, premier tronçon de la ligne de Paris-Nord à Lille, et livraison de l'embarcadère à la compagnie ;
14 juin 1846 : inauguration de la ligne de Paris-Nord à Lille et de l'embarcadère du Nord ;
1861 à 1866 : reconstruction de la gare du Nord, par l'architecte Jacques Hittorff ;
1877 : modification du plan des voies, passage de huit à treize voies ;
1877 : construction d’une halle pour la couverture partielle de la cour arrivée ;
1889 : premier agrandissement, passage de treize à dix-huit voies ;
1900 : second agrandissement, passage de dix-huit à vingt-huit voies ; construction d'une gare-annexe à l'angle des rues du Faubourg-Saint-Denis et de Dunkerque ;
1934 : aménagement de l'avant-gare et redistribution des voies ;
1934 : après la fermeture des voies de petite ceinture, la gare a continué à accueillir des trains de banlieue d’où son nom de « gare annexe » ;
9 décembre 1958 : mise sous tension, en 25 kV – 50 Hz ;
1977 à 1982 : travaux d'aménagement de la gare souterraine, pour les interconnexions nord-sud des lignes B et D du RER ;
mai et septembre 1993 : ouverture de la LGV Nord et mise en service du TGV Nord ;
14 novembre 1994 : premiers services Eurostar, reliant Paris à Londres Waterloo via le tunnel sous la Manche ;
4 juin 1996 : mise en service du Thalys, reliant Paris à Amsterdam via Bruxelles ;
12 juillet 1999 : inauguration de la ligne E du RER et de la gare de Magenta ;
1998 à 2002 : opération « Gare du Nord Échanges ».
Les origines[modifier | modifier le code]
Les différentes zones desservies en fonction de la gare d'origine, celle de la gare du Nord est en bleu foncé.
La façade monumentale de Hittorff, dans les années 1900.
La première Flèche d'or au départ de la gare du Nord vers 1927.
L'ancienne gare-annexe construite pour l'exposition universelle de 1900 (actuellement occupée par un bureau de poste)
Le chemin de fer apparaît à Paris en 1837, avec l'ouverture de l'embarcadère de l'Europe (gare de Paris-Saint-Lazare), rapidement suivi de l'ouverture en 1840 des embarcadères de la barrière du Maine (Paris-Montparnasse) et d'Orléans (Paris-Austerlitz). La loi relative à l'établissement des grandes lignes de chemin de fer en France, votée le 11 juin 1842, décide la réalisation prioritaire d'une ligne reliant Paris à la frontière belge : elle provoque l'édification d'un quatrième embarcadère au nord de la capitale8.
Une première gare du Nord est construite par les ingénieurs des ponts et chaussées pour le compte de la Compagnie des chemins de fer du Nord, sur les plans établis par Léonce Reynaud, professeur d'architecture à l'École polytechnique. Elle est inaugurée le 14 juin 1846, avec l'ouverture de la ligne de Paris à la frontière belge par Lille et Valenciennes. Un dépôt est établi à quelques centaines de mètres au nord, le dépôt de La Chapelle, accompagné d'une remise à voitures à trois kilomètres de Paris, au Landy.
Dotée de seulement deux voies, elle est considérée comme trop petite dès le 21 novembre 1847, lors de l'ouverture de la ligne de Creil à Compiègne dont les trains saturent très vite les installations8. La Compagnie du Nord hésite entre l'édification d'une nouvelle gare réservée aux voyageurs à proximité de l'église Saint-Philippe-du-Roule, reliée à la ligne principale par un embranchement à La Chapelle, et la reconstruction de la gare primitive. C'est finalement la seconde solution qui est retenue de facto9. Le bâtiment est en partie démonté en 1860 pour laisser place à la gare actuelle ; sa façade de pierre est remontée à Lille, par l'architecte de la compagnie Sidney Dunnett10, ce qui n'est pas du goût des édiles de la ville. Surmontée d'un étage et d'une horloge, c'est la façade actuelle de la gare de Lille-Flandres11,12.
Après avoir commandé un avant-projet à Léon Ohnet, le baron James de Rothschild choisit finalement l'architecte français d'origine allemande Jacques Ignace Hittorff. La construction dure de mai 1861 à décembre 1865, mais la nouvelle gare est mise en service dès 1864, l'aile de l'arrivée n'étant pas encore achevée. La surface de la nouvelle gare atteint 36 000 m2, soit le triple de l'ancien embarcadère. Le nombre de voies est porté à huit, dont quatre au centre affectées à la banlieue, encadrées de deux voies pour les départs et deux voies pour les arrivées grandes lignes. Deux voies médianes sont également mises en service entre les voies 2-4 et 5-6, afin de permettre aux machines de s'échapper pour les repositionner en tête des convois. L'avant-gare à hauteur de La Chapelle compte alors six voies, et des sauts-de-mouton sont réalisés afin d'éviter toute interférence entre itinéraires8.
Un trafic de banlieue en hausse constante[modifier | modifier le code]
En effet, le trafic de banlieue connaît une progression rapide, avec l'ouverture de la ligne directe Paris - Creil par Chantilly en 1859, Paris - Soissons en 1861 et Paris - Ermont via Argenteuil en 1863. Dans les années 1860, Haussmann fait élargir la rue de Dunkerque afin de créer la place de Roubaix, qui met en valeur la nouvelle façade, et ouvrir le boulevard de Denain, la reliant au boulevard de Magenta.
Toutefois, ces nouvelles installations atteignent très rapidement le seuil de saturation : l'ouverture de la ligne d'Ermont - Eaubonne à Valmondois en 1876, suivie de la Ligne d'Épinay - Villetaneuse au Tréport - Mers l'année suivante, provoque une nouvelle hausse du trafic. Le nombre de voies à quai passe à treize, dont quatre pour les départs grandes lignes, six affectées au trafic de banlieue, et enfin trois pour les arrivées grandes lignes. Les voies médianes de retournement des machines disparaissent à cette occasion8.
Avec la rapide progression de la fréquentation, qui passe de six à sept millions de voyageurs de 1875 à 1885, le nombre de voies augmente de nouveau. Il passe de treize en 1875 à dix-huit en 1889, pour l'exposition universelle. L'intérieur est alors entièrement reconstruit, avec une redistribution des voies à quai, après la suppression de nombreuses salles d'attente ainsi que de bureaux des messageries. Des extensions latérales extérieures sont également édifiées13.
Les voies se répartissent alors en quatre groupes distincts : voies 1 à 5, groupe Chantilly et départs grandes lignes, voies 6 à 9, groupe Pontoise, voies 10 à 13, groupe Soissons, et voies 10 à 16, groupe arrivées grandes lignes. Les voies 17 et 18 servent pour les trains-tramways de Paris à Saint-Denis et vers Saint-Ouen-les-Docks9.
En 1900, pour une nouvelle exposition universelle, le nombre atteint vingt-huit voies, réparties en quatre groupes : les voies 1 à 5 pour les départs grandes lignes, 6 à 13 pour la banlieue (Pontoise, Valmondois, Montsoult), 14 à 19 pour les arrivées grandes lignes, 20 à 24 pour la ligne de Soissons, 25 à 28 pour les trains-tramways, plus les trains de la Petite Ceinture14. Une nouvelle annexe est alors construite à l'angle des rues du Faubourg-Saint-Denis et de Dunkerque pour les trains tramways et les trains de la Ceinture. La gare nouvelle comporte quatre voies de 130 m environ de longueur utile, desservies par trois quais hauts, partiellement couverts par une halle de 75 m environ de longueur et par un portique sur le quai central. Le bâtiment en bordure de la rue de Dunkerque comprend, au rez-de-chaussée, une vaste salle des pas perdus et les installations accessoires du service des voyageurs ; aux étages, sont installés les bureaux du Contrôle. Les bâtiments secondaires en bordure de la rue du Faubourg-Saint-Denis jusqu'au chemin d'accès à la cour des messageries sont principalement affectés : au rez-de-chaussée, à divers services de la gare, et aux étages, à des logements d'agents et aux bureaux des réclamations. La gare nouvelle étant séparée de la gare principale par la cour des arrivées, un large passage souterrain de 100 m environ de longueur est construit sous la gare. Il est muni à ses deux extrémités d'ascenseurs pour les bagages et éclairé électriquement15,16. En 2016, ce bâtiment est occupé par un bureau de poste.
À partir de 1906 et 1908, elle est desservie par le métro de Paris : la ligne 4 qui traverse Paris du nord au sud, et le terminus de la ligne 5 qui passe près de la gare de Lyon. En 1942, la ligne 5 est étendue en direction de Pantin, en banlieue est.
![[[sticker:p/1kks]]](https://image.jeuxvideo.com/stickers/p/st/1kks)
![[[sticker:p/1jne]]](https://image.jeuxvideo.com/stickers/p/st/1jne)
![[[sticker:p/1kki]]](https://image.jeuxvideo.com/stickers/p/st/1kki)
Données du topic
- Auteur
- CahierDeVictime
- Date de création
- 10 septembre 2017 à 15:42:24
- Nb. messages archivés
- 2278
- Nb. messages JVC
- 2278

![[[sticker:p/1kkn]]](https://image.jeuxvideo.com/stickers/p/st/1kkn)



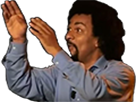
![[[sticker:p/1ljj]]](https://image.jeuxvideo.com/stickers/p/st/1ljj)